Badinter, Kabila, Tshisekedi : la justice n’est pas la vengeance

Condamner Joseph Kabila à la peine capitale, ce n’est pas rendre justice, c’est l’instrumentaliser, selon Michael Sakombi, proche de l’ancien président congolais. Alors que la France rend hommage à l’homme qui a retiré à l’État le droit de tuer, en RDC, c’est la vengeance qui se déguise en droit, affirme-t-il.
Il arrive que les calendriers de l’histoire se répondent, comme par ironie. Le 9 octobre, Robert Badinter est entré au Panthéon à Paris, au nom d’une idée sublime : aucun État, fût-il tout-puissant, ne doit s’arroger le droit de tuer. Au même moment, la RDC condamnait à mort, lors d’un procès jugé bancal par plusieurs observateurs, son seul ancien président de la République encore vivant, Joseph Kabila. Deux gestes, deux civilisations du droit. L’un consacre la victoire de l’humanité sur la vengeance. L’autre proclame le retour de la peur comme méthode de gouvernement.
C’est dans cet écart que se lit notre époque : la France enterre la mort au Panthéon, le Congo la ressuscite brutalement au tribunal.
Robert Badinter disait que la justice n’a de sens que si elle arrache l’homme à la violence primitive. En abolissant la peine de mort, il affirmait que « l’État de droit commence là où s’arrête le droit de tuer ». C’était plus qu’une réforme, c’était une conversion morale de la République. Quarante-quatre ans plus tard, à Kinshasa, cette conversion semble inachevée. Dans la condamnation de Joseph Kabila, ce n’est pas le droit qui parle, c’est la vengeance qui se déguise en droit. Ce n’est pas le juge qui tranche, c’est le pouvoir qui règle ses comptes.
En 1981, le garde des Sceaux de François Mitterrand n’a pas seulement aboli la peine de mort en France. Il a accompli un acte de civilisation en arrachant à l’État la tentation de la vengeance. Il a transformé la justice, non plus en instrument de peur, mais en école d’humanité. Il a su ce que tant de dirigeants refusent toujours de comprendre : un État qui tue n’affirme pas sa force, il confesse sa faiblesse. Il ne gouverne plus par la raison, mais par la peur.
Et c’est cette peur, de l’autre, du passé, du jugement, qui semble guider les autorités congolaises dans cette affaire. Le spectacle de mauvais goût vécu lors des audiences de la Haute Cour militaire, avec des avocats zélés de la République grassement payés en millions de dollars, une grave entorse morale ainsi que l’étalage de preuves risibles attestant les charges, inutilement lourdes, contre l’accusé, n’ont d’égal que la forfaiture originelle commise depuis la levée illégale des immunités au Sénat.
Condamner Joseph Kabila de cette manière à la peine capitale, ce n’est pas rendre justice : c’est l’instrumentaliser. Ce n’est pas juger un homme, c’est effacer une époque et transformer la mémoire en champ de bataille. Cette peine pèse désormais comme un glaive suspendu sur la conscience nationale à l’image de l’épée de Damoclès. Elle ressuscite les fantômes de nos divisions profondes : Lumumba trahi, Kasa-Vubu ostracisé, Mobutu exilé, Laurent-Désiré Kabila assassiné et maintenant son fils condamné à mort. À chaque génération, le Congo semble vouloir se venger du passé au lieu de le comprendre pour un meilleur futur. À chaque époque, il recommence le procès de son histoire, au lieu d’en écrire la suite tout en brisant son rétroviseur. Une « malédiction des chefs » ne rôde-t-elle pas sur nous, tels les mythes insolubles du tonneau des Danaïdes et de Sisyphe ?
« Là où l’État tue, le droit s’éteint »
Joseph Kabila n’est certes pas au-dessus des lois. Mais il n’est pas non plus en dehors de l’histoire. Qu’on l’aime ou pas, qu’on l’exècre ou le conteste, le raïs a indéniablement incarné la résilience de l’État congolais : la fin d’une guerre africaine fratricide sur notre territoire, la réunification et la réconciliation nationales post-Sun City, la Constitution du 18 février 2006, le state building institutionnel et normatif, la relance économique et in fine, l’alternance historique du 24 janvier 2019.
Son procès n’est donc pas celui d’un homme : c’est celui d’une époque que certains veulent effacer. Le condamner à mort, c’est condamner le principe même de la continuité d’un État avec ses fragilités historiques et ses défis existentiels. C’est effacer le lien entre la guerre et la paix, entre l’autorité et la légitimité. Robert Badinter nous a appris qu’abolir la peine de mort, c’est abolir la barbarie d’État. La restaurer, c’est y retomber. Là où l’État tue, le droit s’éteint et la nation se renie.
Une justice qui veut tuer un ancien chef d’État élu sans preuve de crime de sang, c’est un État qui s’entretue symboliquement. C’est l’histoire nationale qui devient victime collatérale d’un règlement de comptes. La France, en 1981, choisit la civilisation. Le Congo, en 2025, choisit la régression.
Robert Badinter repose désormais sous la coupole du Panthéon, où la République française honore ceux qui ont su préférer la conscience à la force. Son cercueil entre là où les rois n’entrent pas, mais où les justes demeurent. Et pendant qu’à Paris on célèbre l’homme qui a retiré à l’État le droit de tuer, à Kinshasa, l’État revendique de nouveau ce droit. L’ironie est tragique, mais l’enseignement est universel : chaque nation doit choisir entre la dignité et la peur. Entre la justice et la vengeance. Entre la République et la barbarie.
« La levée du moratoire est une faillite politique »
Cet avocat de la vie, amateur de Condorcet, croyait que la justice devait sauver l’homme jusque dans sa faute. Dans la tradition chrétienne, la vie humaine n’appartient qu’à Dieu et l’État qui tue usurpe le divin. Dans les Évangiles, le Christ refuse de condamner la femme adultère. Il écrit dans le sable et dit : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ». Ce geste n’est pas une faiblesse : il est la fondation même de la justice moderne qui ne se mesure pas à la force du châtiment, mais à la grandeur du pardon. Le président Félix Tshisekedi, qui pourtant a consacré publiquement le pays à Dieu à l’entame de son mandat, n’aurait-il plus souvenir de ce passage ?
La politique n’est pas le règne du glaive : elle est l’art du lien. Et lorsqu’un État brise ce lien par la mort, il rompt avec sa propre humanité. La levée du moratoire sur la peine de mort n’est pas seulement une erreur morale : elle est une faillite politique et traduit la peur d’un pouvoir qui ne sait plus convaincre et qui, faute de légitimité, croit devoir punir pour gouverner.A lire :
RDC – Adolphe Muzito : « En temps de guerre, on doit tous travailler ensemble »
Le Congo, comme tant d’autres nations africaines, n’a pas besoin de nouveaux bourreaux : il a besoin de nouveaux humanistes. Il a besoin de Robert Badinter, d’hommes ou de femmes qui oseraient dire non à la mort, non à la haine, non à la vengeance. La France a choisi la lumière du droit. Le Congo, par cette condamnation, s’est enfoncé dans la nuit du soupçon. Mais il n’est pas trop tard.
Les nations, comme les hommes, ont droit à la rédemption. Il suffirait d’un geste. Non, que dis-je, de trois : proclamer de nouveau l’abolition de la peine de mort, non par contrainte, mais par conscience. Annuler ces décisions iniques de mort qui frappent plusieurs compatriotes, comme le demandait dans un récent article l’analyste belge Jean-Jacques Wondo, qui a vécu dans sa chair ce calvaire dans le couloir de la mort et, last but not least, lancer un processus sincère de réconciliation nationale par un dialogue inclusif entre frères et sœurs.
C’est à ces conditions que la RDC pourra se dire véritablement républicaine, non par le nom mais par la morale. La justice, écrivait Paul Ricœur, « n’est pas vengeance des hommes, elle est mémoire de la fraternité ». Que ce mot redevienne la boussole du Congo.

Michael Sakombi
Diplomate, ancien vice-gouverneur de la province de la Mongala en RDC et membre du bureau politique du PPRG

 Rwanda and DRC leaders sign Trump-brokered peace deal, despite new violence
Rwanda and DRC leaders sign Trump-brokered peace deal, despite new violence 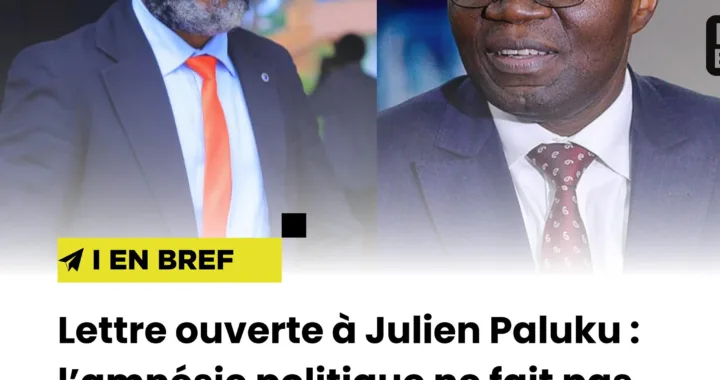 Lettre ouverte à Julien Paluku : l’amnésie politique ne fait pas un patriote !
Lettre ouverte à Julien Paluku : l’amnésie politique ne fait pas un patriote !  Une vendetta en RD Congo
Une vendetta en RD Congo  Dominique Sakombi Inongo, quinze ans déjà : héritage vivant, avenir commun
Dominique Sakombi Inongo, quinze ans déjà : héritage vivant, avenir commun 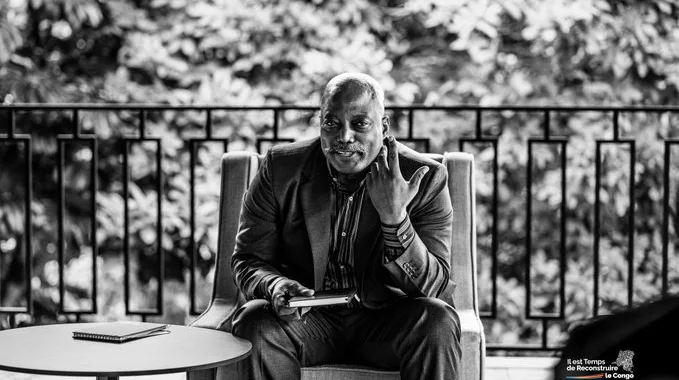 Joseph Kabila Kabange ou l’incarnation de la stature, du silence et de la mémoire souveraine de l’État
Joseph Kabila Kabange ou l’incarnation de la stature, du silence et de la mémoire souveraine de l’État  En RDC, Joseph Kabila met Félix Tshisekedi en garde : « Tôt ou tard, la supercherie sera évidente pour tous »
En RDC, Joseph Kabila met Félix Tshisekedi en garde : « Tôt ou tard, la supercherie sera évidente pour tous »